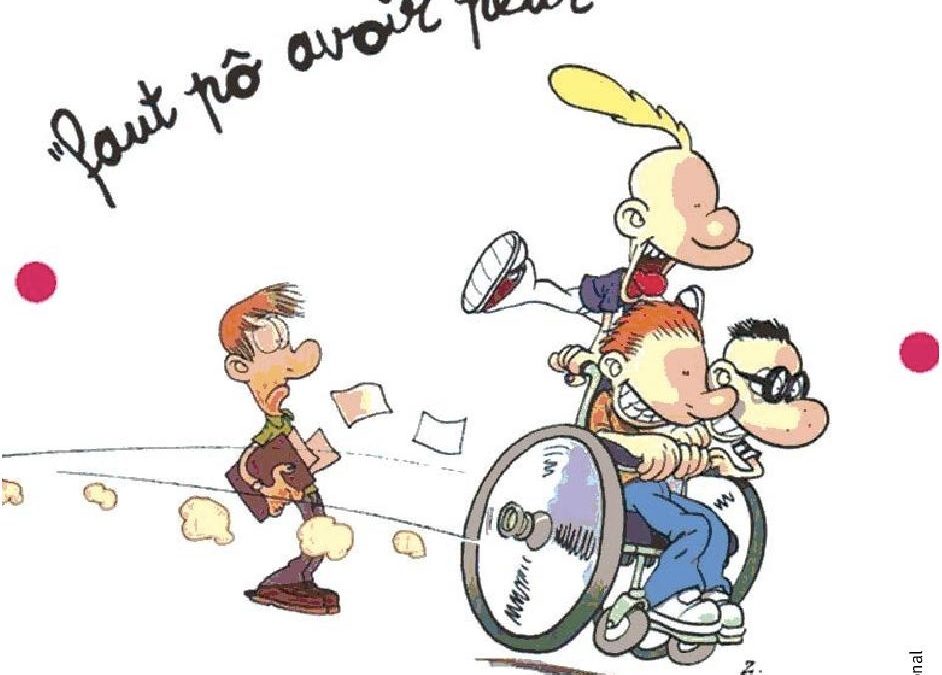![A paraître : « Chez moi / Chez nous : [co]habiter le monde »– NVL 237 – Septembre 2023](https://www.nvl-larevue.fr/wp-content/uploads/2023/09/NVL237-978x675.jpg)
par Elise Meunier | Sep 7, 2023 | Articles
Continuant à explorer la voie fondamentale de l’écopoétique, NVL observe comment la littérature jeunesse donne sens à la formule Habiter le monde. Il s’agit de penser le Chez- soi, rêve légitime d’un havre pour chaque vivant, comme un incontournable Chez-nous. La fiction et l’imaginaire qu’elle met en route aidera -t-elle à saisir qu’il s’agit bien de (co)habiter le monde ? Il est remarquable que 5 des collaborateurs à ce numéro soient des jeunes, chercheurs ou étudiants concernés par ce sujet brulant.
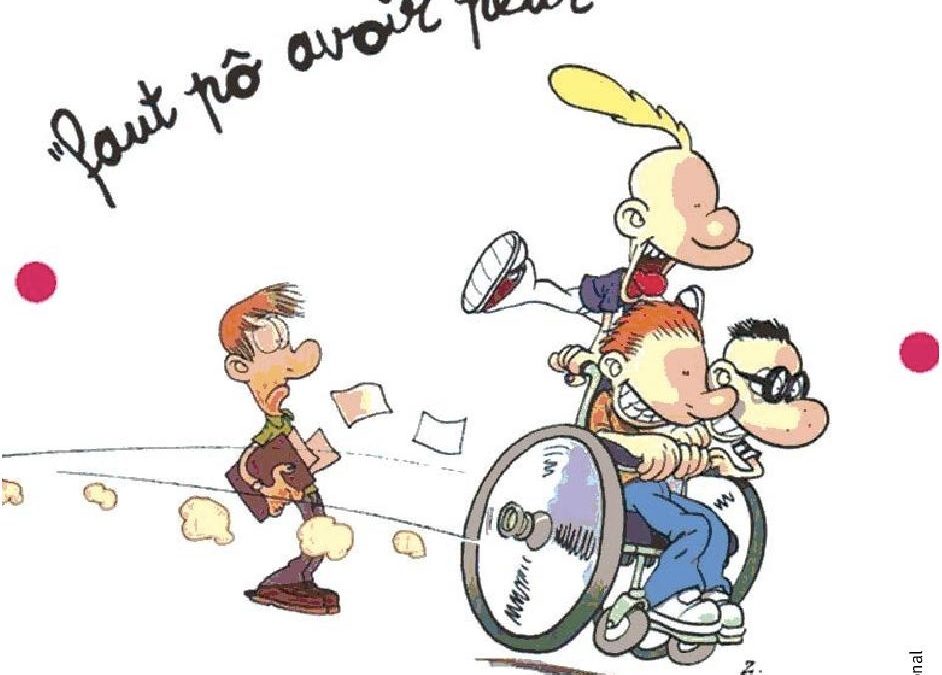
par Elise Meunier | Mar 28, 2023 | Actus livre jeunesse, Articles, Nos actus
Dans le cadre de l’Escale du Livre de Bordeaux, rendez-vous le dimanche à 2 Mars, à 15h30 à l’IUT amphi 2.
Conférence Cap/Pas cap/ Handicap – durée 1h – Tout public : Avec la revue Nous voulons lire!
A une époque où l’inclusion des personnes en situation de handicap est définie par la loi et où l’on commence à pointer du doigt le validisme, qu’en est-il de la représentation du handicap dans la littérature jeunesse ? Présentée par Claudine Charamnac-Stupar

par Elise Meunier | Mar 28, 2023 | Actus livre jeunesse, Articles, Nos actus
Retrouvez- nous à la 21e édition de l’Escale du livre à Bordeaux. Nous serons à la Librairie Vitez, au stand V12, les 31 mars, 1 et 2 avril. A bientôt !

par Elise Meunier | Mar 23, 2023 | Actus livre jeunesse, Articles, Nos actus
LES OISEAUX ? un motif littéraire banal trainant tout un filet de symboles ? c’est que l’oiseau reste pour l’enfant et l’adulte tout à la fois, fragile et immensément libre, farouche et d’une présence familière. Sa richesse graphique en fait aussi un motif récurrent dans l’album. Mais que serait un monde sans oiseaux ? les inquiétudes actuelles en font un écomotif dont les fictions qui vont nourrir l’imaginaire des enfants seront les plus sûrs garants d’une prise de conscience : nous avons grand besoin des oiseaux.

par Elise Meunier | Mar 1, 2023 | Articles, blog
Nos abonnements sont à l’année civile. Pour 2023, nous avons maintenu, contre vents et marées économiques, le tarif 2022. Mais, en raison de l’envolée des frais postaux, toute commande d’abonnement arrivée après la parution de ce 1er numéro de l’année et nécessitant l’envoi d’1 ou 2 revues hors routage normal se verra facturer les frais d’envoi , soit :
commande après le 10 mars 2023= + 4,96€
commande après le 10 juin 2023= + 6,55 €

par Elise Meunier | Déc 14, 2022 | Articles
Dans ce numéro, nous achevons de tirer le fil rouge des discriminations, qui passait par les censures et réécritures sous l’effet woke (228), le racisme (229), le sexisme (230), des discriminations qui alourdissent aussi la vie des personnes en situation de handicap (dont un pourcentage important d’enfants et d’adolescents).
L’illustration de couverture est de Célia Chauffrey dans son album Matachamoua, aux éditions Pastel-Ecole Des Loisirs.
![A paraître : « Chez moi / Chez nous : [co]habiter le monde »– NVL 237 – Septembre 2023](https://www.nvl-larevue.fr/wp-content/uploads/2023/09/NVL237-978x675.jpg)